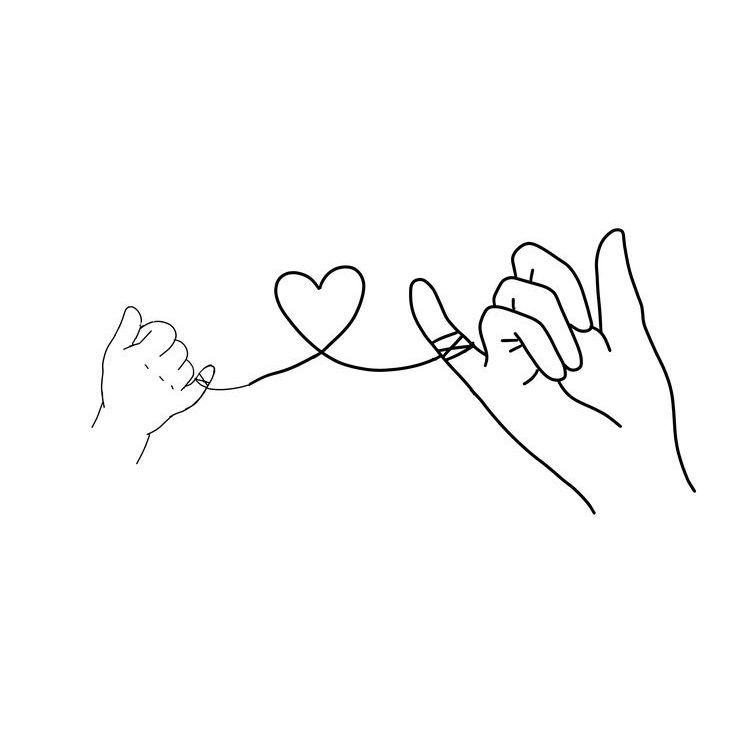Il y a des moments où l’on croit avoir enfin été entendue.
Des instants où l’on pense que nos mots ont traversé le mur, qu’ils ont touché quelque chose chez l’autre.
On se dit que cette fois, c’est différent.
Que la conversation a porté.
Que la considération est réelle.
Et puis un détail.
Une phrase.
Un “oui, mais”.
Et le miroir sans tain se brise.
Il y a des prises de conscience qui ne font pas de bruit.
Et puis il y a celles qui claquent.
Celles qui ne crient pas, mais qui fissurent tout à l’intérieur.
Je pensais avoir été entendue.
Je pensais avoir été écoutée.
Je pensais, enfin, avoir été considérée.
Après plusieurs conversations profondes, sincères, parfois douloureuses, j’ai cru que quelque chose avait bougé.
Que mes mots avaient traversé.
Qu’ils avaient été reçus.
Je me suis dit :
Ça y est. Cette fois, on m’a comprise.
Et puis, presque sans prévenir, le miroir sans tain s’est effondré.
Encore ce matin.
Je dis :
« J’ai besoin de ça. »
« Je veux ça. »
Des phrases simples.
Claires.
Posées.
Et en face, la réponse :
« Oui mais en même temps… »
« Ce serait bien que… »
« Il faudrait que… »
Encore.
Toujours ce “mais” qui invalide.
Toujours cette manière de reformuler ma vie à ma place.
Toujours cette sensation que ce que je dis est entendu… mais pas accepté.
On me répond.
Mais on ne m’écoute pas.
On me parle.
Mais on ne me considère pas.
Et ce n’est pas nouveau.
La différence, c’est que maintenant, je le vois.
Je me suis rendu compte récemment de la façon dont j’étais traitée avant.
De la manière dont, pendant longtemps, je me suis adaptée.
Je me suis tue.
Je me suis ajustée.
Et lorsque j’ai enfin osé dire ce que je voulais, ce dont j’avais besoin, j’ai cru que les choses avaient changé.
Mais non.
On m’a donné l’illusion d’être entendue.
On m’a donné l’illusion d’être reconnue.
Et lorsque j’ai réaffirmé mes besoins, le mécanisme est revenu.
Automatique.
Presque réflexe.
Comme si ma parole devait toujours passer par un filtre.
Comme si mes choix avaient besoin d’être validés.
Corrigés.
Orientés.
Et sur le coup, quand on est en reconstruction, ça fait mal.
Ça donne l’impression de revenir en arrière.
De retomber au point de départ.
De se dire :
Encore une fois, je ne suis pas suffisante.
Encore une fois, je dois me justifier.
Mais en réalité, ce n’est pas un retour en arrière.
C’est une marche descendue pour mieux comprendre comment gravir les suivantes.
Parfois, j’ai l’impression d’être un miroir sans tain.
On me regarde.
On me parle.
Mais on ne me voit pas vraiment.
Parce que me voir, ce serait se voir soi-même.
Et ça, c’est inconfortable.
Peut-être que certains préfèrent l’illusion.
L’illusion d’avoir raison.
L’illusion d’être justes.
L’illusion de savoir ce qui est bon pour moi.
Peut-être que me laisser décider, c’est accepter qu’ils n’ont pas le contrôle.
Et ça dérange.
Mais ma vie ne leur appartient pas.
Elle ne leur a jamais appartenu.
Je ne suis pas une poupée Barbie qu’on place dans une maison de poupée.
Qu’on habille selon ses envies.
À qui l’on fait dire ce que l’on veut entendre.
À qui l’on impose un rôle.
Je ne suis pas un personnage secondaire dans le scénario des autres.
Aujourd’hui, je récupère ma place.
Celle que j’aurais toujours dû occuper.
Pas celle qu’on a voulu me faire occuper.
Pas celle que j’ai accepté d’habiter par peur, par amour, par besoin d’être aimée.
Je ne suis plus cette version de moi qui s’adapte pour survivre.
Je ne suis plus celle qui se plie pour éviter le conflit.
Je ne suis plus celle qui laisse les autres définir l’espace qu’elle a le droit de prendre.
Oui, on a parfois voulu décider pour moi.
Oui, on a projeté sur moi des attentes qui n’étaient pas les miennes.
Mais j’ai aussi, à un moment donné, laissé faire.
Par peur d’être rejetée.
Par peur de déplaire.
Par peur d’être seule.
Aujourd’hui, je ne me condamne pas pour ça.
Je me comprends.
Et surtout, je choisis autrement.
Je récupère ma souveraineté.
Je reprends la place que j’aurais toujours dû occuper :
la mienne.
Entière.
Non négociable.
Non modelable.
Non ajustable au confort des autres.
Je ne suis plus le miroir qu’on regarde sans jamais oser se voir dedans.
Je suis un être vivant, pensant, ressentant.
Et ma vie m’appartient.
Je ne la confierai plus aux mains de ceux qui veulent la diriger.
Ce n’est pas une rébellion.
Ce n’est pas une guerre.
C’est une reconquête.
Calme.
Lucide.
Irréversible.
On peut ne pas être d’accord avec mes choix.
On peut être dérangé par mes limites.
On peut être bousculé par ma fermeté.
Mais ma vie m’appartient.
Et c’est non négociable.
Je ne suis plus la poupée de personne.
Je ne me laisse plus manipuler ni influencer par la peur de déplaire.
Je vis ma vie selon mes propres envies.
Selon mes propres besoins.
Selon mes propres décisions.
Et si cela déplaît,
ce n’est plus mon problème.
Élyra Solän.